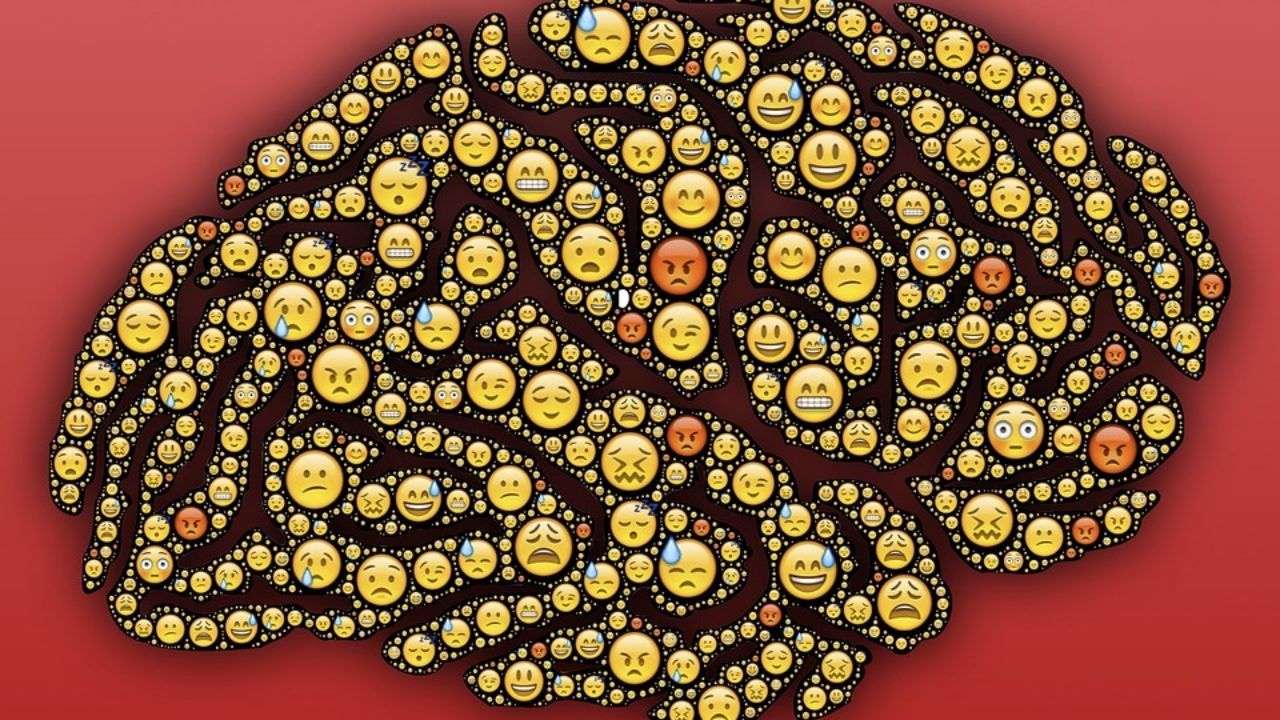
References :
- Foucault, M (1983). Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia. 6 lectures at University of California at Berkeley, CA, Oct-Nov. 1983.
- Foucault, M. (2001). L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France (1981-1982). Paris : Gallimard/Le Seuil.
- Foucault, M. (2009). Le courage de la vérité: Le gouvernement de soi et des autres II: Cours au Collège de France (1983-1984). Ed. Gros, Frédéric, A. Gallimard; Seuil: Paris.
- Matheron, A. (1988). Individu et communauté chez Spinoza. Le sens commun. Paris. Minuit.
- Spinoza, B. D., & Misrahi, R. (1993). Spinoza. Ethique. Introduction, traduction, notes et commentaires de Robert Misrahi. (Deuxième édition). Puf, Philosophie d’aujourd’hui.


#CollectiveAffect
☀️ Oui Spinoza ✴️ sur nos inclinations et désirs, nous invite à penser les affects…
Cette valeur imaginée individuellement dans telle ou telle chose devient bien vite un “affect commun”…
Matheron (1988) reprend à Spinoza, la “potentia multitudinis”, qui permet à la puissance affective de se former…
On retrouve cela dans tous les groupes… se traduisant par l’adhésion, l’intensité affective, qui enjointes à des pensées, se transforme en une opinion, ou une croyance fortement ancrée dans ce collectif…
Michel Foucault utilisait un terme dissonant ici, la “parrhesia”…